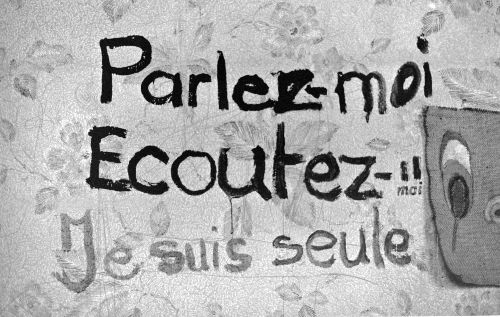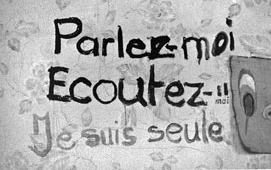Anne Feuillère : Vous aviez déjà réalisé de nombreux films avant Magnum Begynasium Bruxellense. Quelle place occupe ce film dans votre filmographie ?
Boris Lehman : J’ai commencé à faire du cinéma dès l’âge de 14 ans, comme simple amateur. Je suis entré à l'INSAS en 1962, quand cette école s’est créée. À cette époque je faisais des films de toutes sortes, documentaires, scientifiques, expérimentaux, fictions improvisées, en 8 et en 16mm… À partir du début des années 1970, mon cinéma est devenu un peu plus « professionnel ». Tout ça est venu assez naturellement. Magnum Begynasium Bruxellense est un film qui découle d'une expérience d'animation de quartier. C'est une chose qui ne se faisait pas, mais qui, maintenant, est assez courante. C'était aussi lié au travail que j'effectuais au Club Antonin Artaud, centre de réadaptation pour malades mentaux qui fut créé en 1962 dans le courant des mouvements anti-psychiatriques (alternative à la psychiatrie institutionnelle). Ainsi, les intervenants et les participants furent essentiellement des gens du quartier et des malades mentaux. Il y avait très peu de professionnels dans l'équipe. Le tournage a duré environ 2 années et le montage une de plus. Philippe Boesmans, qui n'était pas encore le grand compositeur d'opéra qu'il allait devenir par la suite, a composé la musique du film. Une espèce de ritournelle (dodécaphonique) pour guitare, qui pouvait être découpée et placée sur les images un peu comme des ponctuations. Il n'y avait pas vraiment de scénario au départ, nous voulions faire une chronique, un inventaire du quartier. Ce film fut une expérience fondatrice pour mon cinéma, qui se voulait un cinéma libre, indépendant, artisanal, hors du système des contraintes de production. Cela demandait sans doute certains sacrifices (surtout du point de vue pécuniaire).
A.F. : Pourquoi, à votre avis, ce film a-t-il fait date ?
B.L. : J'aurais « inventé » un genre qui s'est propagé à cette époque et qui n'existait pas encore, qu'on a appelé « documentaire-fiction ». Le film ne comportait pas d'explication, ni de commentaire. C'était une vision poétique de Bruxelles, mais pas seulement un film documentaire contemplatif, c'était surtout une réflexion sur le temps et la mort (la mort des gens, mais aussi la disparition d'un quartier), thèmes qui sont revenus comme un leitmotiv dans presque tous mes films ultérieurs, jusqu'à mon dernier Funérailles (de l'art de mourir). Le film a été invité dans une quarantaine de festivals, dont Cannes, Berlin, Rotterdam, Mannheim, Nyon, Figueira da Foz, New York, Montréal et même Hong Kong. Il était programmé à la télévision belge (RTB) sur le premier programme, à 20 heures (ce qui serait inimaginable aujourd'hui) et a été montré dans pas mal de homes, centres culturels et cinémathèques. Tous ceux qui l'ont vu, de Henri Storck à Chantal Akerman, de René Allio à Nicolas Philibert, de Jacques Leduc à Gérard Mordillat, Richard Dindo, Frederick Wiseman, Johan van der Keuken, l'ont porté aux nues. Il y avait sans doute, en germe, une écriture quelque peu « moderne » basée sur des plans fixes plutôt longs, qui enregistraient la durée réelle, « en direct ». À la même époque, Wim Wenders et Chantal Akerman faisaient ça aussi.
A.F. : Comment vous positionniez-vous dans le cinéma belge par rapport à ces cinéastes ?
B.L. : Ceux qui m’ont le plus appris (ou influencé) dans le cinéma en Belgique, ce sont Edmond Bernhard (grand poète méconnu, l’auteur notamment de Dimanche) et Henri Storck, avec qui j’ai travaillé (comme assistant, comme monteur) pendant quatre ans, mais aussi des professeurs que j’ai rencontrés à l’INSAS, comme André Souris (musicien du groupe « surréaliste »), Antoni Bohdziewicz (l’un des fondateurs de l’école de Lodz), Henri Colpi (le monteur de Hisroshima mon amour), Ghislain Cloquet (l’opérateur de Bresson)… J’aimais beaucoup les films de Paul Meyer (Klinkaart, Déjà s’envole la fleur maigre).
A.F. : Aujourd’hui, comment percevez-vous votre film, avec le recul ?
B.L. : Il a pris un air plus nostalgique, également ethnographique et archéologique, malgré lui. Ce n'était pas prémédité.
A.F. : Baudelaire fait une belle distinction entre la mélancolie et la nostalgie. Il dit que la mélancolie est le sentiment du temps qui passe et la nostalgie, le sentiment du temps passé... Magnum est mélancolique ou nostalgique ? Et n'est-ce pas le cas de nombre de vos films ?
B.L. : Mélancolique et nostalgique, oui. Entièrement d’accord. Vous savez, Baudelaire, qui détestait la Belgique (et qui l’a écrit dans des poèmes assez acerbes comme Pauvre Belgique, la Belgique toute nue), a aimé une seule chose : l’Église du Béguinage. Il la comparait à une jeune et belle communiante.