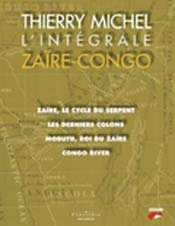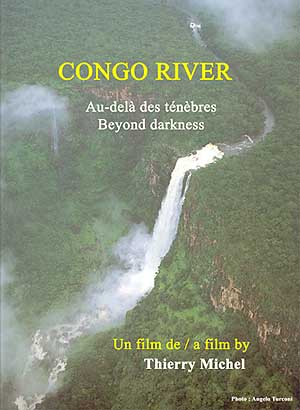Le film s’ouvre sur une séquence de Stanley et Livingstone, le film de 1939 d’Henry King et Otto Brower. Spencer Tracy, en Stanley dans le bureau londonien d’un directeur de presse, s’entend décrire le fabuleux mystère de cette région sauvage et inexplorée que constituait, à son époque, le bassin du Congo. Cette vision pionnière, directement issue du passé colonial, est immédiatement confrontée avec les images du fleuve aujourd’hui (superbes vues aériennes des chutes d’Inga). Sans plus de transition, nous embarquons sur une des barges qui remontent le fleuve depuis Kinshasa jusqu’à Kisangani, 1.700 km plus loin. Elle est chargée à ras bord de marchandises et de passagers qui s’installent au petit bonheur sous une bâche, entre deux caisses, à l’abri d’une encoignure. Très rapidement, se constitue une vraie micro-société où chacun tient sa place. À l’avant de la barge, les sondeurs armés de longs bâtons fouillent le fleuve à la recherche des hauts fonds ou des bancs de sable à éviter absolument. Ils communiquent par gestes avec le pilote et le commandant, attentifs à la barre, au moindre frémissement de la surface qui trahirait un piège caché. Le fleuve n’est plus balisé depuis des années, les seules cartes dont on dispose sont de vieux rouleaux de papier jaunis datant d’avant 1960, et sur les trois moteurs de la barge, un seul fonctionne encore. Au cours de ce périple de plusieurs semaines, nous nous intégrons à la vie du bateau, mais nous descendons aussi à terre, à la rencontre des vestiges du passé que quelques personnages tentent désespérément de préserver pour un avenir meilleur : une ancienne herboristerie universitaire ou les précieuses collections de plantes et de spécimens naturalisés dorment dans de grandes armoires sous la garde attentive d’un seul ancien professeur, ou encore le palais de Mobutu qui tombe en ruine malgré les efforts de son gardien d’une opiniâtreté admirable mais bien dérisoire, hélas. Et partout, le cinéaste parsème son film d’étonnantes petites séquences d’archives par lesquelles les fantômes de l’histoire telle qu’elle est écrite par les blancs et leurs successeurs reviennent hanter le Congo d’aujourd’hui.
Après une heure de film environ, nous arrivons à Kisangani. Il faut alors quitter la barge, et continuer par des moyens de fortune vers la source du fleuve, à travers des régions de plus en plus dévastées, livrées au pillage et aux exactions de chefs de bande d’une sauvagerie inimaginable. Le ton du film change alors nettement. Il est difficile, à vrai dire, de soutenir la comparaison avec l’extraordinaire potentiel cinématographique offert par ce voyage en barge, mais il nous faut nous confronter à ces zones d’ombre où la civilisation a perdu la plupart de ses droits. Ce sont les témoignages des médecins et infirmiers faisant face avec les moyens du bord à la cohorte de blessés, brutalisés, torturés, meurtris dans leur chair et dans leur esprit. Ce sont les regards insoutenables de femmes, de fillettes, prostrées, muettes, sur leurs lits d’hôpital. C’est le témoignage du chef des guerriers Maï Maï qui s’est taillé un fief au cœur de la forêt, et qui retrouve dans la bible, des citations qui, selon lui, annoncent comme des prophéties, sa venue et ses actes. Grâce à elles, prenant le cinéaste à témoin, il justifie ses brigandages. On voit l’emprise, de plus en plus grande, d’églises aux pratiques sectaires. Dans ces populations déboussolées, elles récupèrent aisément une spiritualité profonde, teintée d’un vieux fond d’animisme à des fins infiniment plus terre-à-terre. Le tiroir-caisse tinte, des puissances s’érigent. Cet inventaire mortifère pourrait être d’une incroyable morosité, mais Thierry Michel refuse la fatalité. Partout, il cherche l’herbe qui repousse sur les cendres, les sociétés qui se réorganisent, les gens qui luttent contre toute évidence pour tenter de rendre à nouveau la vie vivable. Ce n’est pas par hasard que le réalisateur, en référence à Joseph Conrad, sous-titre son film, non pas « Au cœur… » mais « Au-delà des ténèbres ».
On le voit, le film de Thierry Michel est d’une richesse et d’une densité rare. On y aborde de très nombreux sujets, trop peut-être. Le spectateur, qui cherche à rassembler et à mettre en musique toutes les informations qu’évoquent ces séquences, se perd un peu dans la réalité complexe d’un pays lointain, d’une culture très différente de la sienne. Mais peut-être ne faut-il pas, justement, trop chercher à comprendre. Thierry Michel a résolument opté pour une approche impressionniste. Il nous livre un puzzle de sensations, d’impressions, d’émotions. Pour en saisir la globalité, pour aller au cœur de ce que le cinéaste cherche à transmettre, il est sans doute nécessaire de se laisser aller au fil du voyage sans trop s’appesantir sur les étapes. Alors, il devient possible de dégager de ce portrait aux multiples facettes sa propre vision d’une Afrique en pleine mutation.