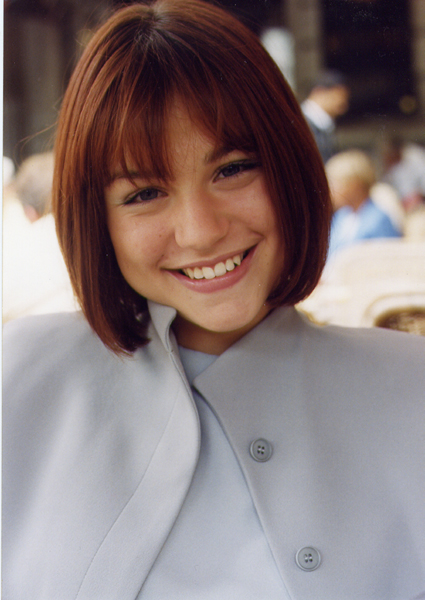Philippe Manche : A perdre la raison est librement inspiré de l’affaire Geneviève Lhermitte, comme cela est d’ailleurs précisé à la fin du film. A quoi ce fait divers a fait écho chez l’homme et le cinéaste que vous êtes pour avoir envie de le décliner sur le grand écran ?
Joachim Lafosse : Pour passer trois ans de sa vie sur un film, il faut être attrapé par quelque chose d’intime. Quand j’entends à la radio parler de l’affaire Lhermitte, ça résonne. A ce moment-là, je ne peux pas dire pourquoi. Je me suis rendu compte après avoir fait le film que c’était bien plus un long métrage sur l’abus que sur l’infanticide. C’est probablement cette part-là de l’affaire qui a résonné. Ensuite, avant d’être un cinéaste, je suis un énorme lecteur et spectateur de théâtre et, cette histoire, c’est Médée. De Pasolini à Bob Wilson en passant par Henry Bauchau, tout auteur a envie de se confronter à Médée. J’y suis allé.
P.M. : Comment vivez-vous la polémique qui entoure la genèse de A perdre la raison ?
J.L. : C’est quand même un film qu’on fait dans un grand confort financier et qui a été très bien produit. Ensuite, il y a la manière dont les médias se sont emparés de la possibilité de faire un film de cette affaire. La polémique a commencé avant que je ne fasse le film. Les gens qui se sont emparés de cette question n’avaient, à raison, pas lu le scénario. Par contre, la Communauté Française et les institutions qui soutiennent le cinéma ont eu affaire au concret du scénario pendant que la polémique avait lieu. Tous les gens qui lisaient le scénario trouvaient que le propos était très nuancé ; c’est sain, ce n’est pas vulgaire, il n’y a pas de jugement. Et quelque part, c’est assez logique. Quand on voit la manière dont la presse est malmenée aujourd’hui par les extrêmes, je trouve plutôt sain que des journalistes se soient posé la question du sens qu’il y avait, avant de faire ce film, à le faire. Ce que je trouve aussi chouette, et c’est rassurant démocratiquement, c’est qu’une fois que le film a été montré, on a eu affaire aux critiques de cinéma et celles-ci ont été très bonnes. Tout ça m’a obligé à avoir une vigilance qui est assez honorable, finalement.
P.M. : L’équilibre, la justesse de ton, l’absence de jugement des personnages, … Tout ça se construit lors de l’écriture du film ?
J.L. : C’est dans le travail. La justesse ne se trouve qu’en travaillant, mais aussi en acceptant la critique et en écoutant. C’est pour ça que je coécris, parce que je pense qu’il y a plus dans deux têtes que dans une, qu’on réfléchit mieux à deux que tout seul. Toujours. C’est aussi pour cela que je ne suis pas contre les producteurs, parce que c’est intéressant de les entendre. Quand on accumule et qu’on additionne tous ces avis, on arrive toujours à une justesse, mais il faut être capable d’entendre. En même temps, je ne cherche pas la course au succès, je cherche la justesse ; ce n’est pas la même chose. Par ailleurs, je n’ai pas envie de juger. Il n’y a pas les bons et les mauvais, parce que, même chez ces derniers, il y a des raisons pour lesquelles ils sont mauvais. Ce n’est pas noir ou blanc. Jamais. C’est la politique qui nous fait basculer du côté des riches et des pauvres, c’est le manichéisme qui ne peut pas être du côté du cinéma.
P.M. : Quelle est votre « famille » dans le cinéma belge francophone ?
J.L. : Les frères Dardenne, c’est indéniable et non négociable. Ensuite, Marco Lamensch et Jean Libon, pour ce qu’ils ont créé et initié avec « Striptease » et pour la possibilité d’avoir créé un regard anarchiste au sein de notre Communauté ; c’est formidable. Je pense aussi à Chantal Akerman et son film Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles qui ouvre un œil sur tout un pan du cinéma mondial qu’on oublie. Et Paul Meyer et Déjà s’envole la fleur maigre. Ce n’est pas une œuvre, mais c’est un film.
Philippe Manche